
Violences gynécologiques
et obstétricales :
on en est où ?
Encore peu présentes dans le débat public, les violences gynécologiques et obstétricales sont pourtant un véritable enjeu de santé publique. Nelly Reliat, experte santé et genre à l'AFD, décrypte ce sujet pour Tilt.
Nelly Reliat est Responsable d'équipe projet dans la Division Santé & Protection sociale de l'AFD. Elle travaille plus particulièrement sur les sujets de genre, de protection des droits dans le cadre de l'accès à la santé, notamment les droits à la santé sexuelles et reproductive (DSSR) et la lutte des violences basées sur le genre.

Tilt : Peux-tu définir les violences gynécologiques et obstétricales ?
Les « violences gynécologiques et obstétricales » (VGO) sont des violences que subissent les femmes et les filles lorsqu’elles consultent des spécialistes de la santé des femmes. Cela peut avoir lieu pendant leur suivi gynécologique, leur grossesse, l'accouchement, post-partum, l’IVG, la ménopause... Ce sont des violences commises par tous types de personnels de santé impliqué dans ce suivi, aussi bien homme que femme, et qui se manifestent par des pratiques abusives ou violentes sur les patientes.
On peut regrouper ces violences en 5 grandes catégories :
- Les violences physiques : ce sont les plus visibles, avec par exemple l’usage de la force sur des patientes pendant leur accouchement, lorsque les femmes sont battues, giflées, bâillonnées, voire attachées.
- Les violences sexuelles : par exemple des viols subis dans le cadre du suivi gynécologique ou obstétrique – on entend de plus en plus parler de « viols gynécologiques ».
- Les violences verbales : moins ‘visibles’, mais tout aussi brutales, elles incluent les violences verbales comme des injures, des menaces ou des critiques
- Les commentaires discriminants et stigmatisants : en lien avec l’âge de la patiente, son statut socioéconomique (si elle est très pauvre) ou marital (les adolescentes non mariées ou les femmes divorcées sont plus fortement discriminées dans leur suivi gynéco-obstétrique dans de nombreux contextes…) condition médicale (VIH), la sexualité d’une patiente, ethnie, sa race, religion…
- Le non-respect des standards professionnels par les personnels de santé : cela englobe tous les actes médicaux délibérément douloureux, inutiles ou non consentis, pratiqués sans le contentement de la patiente ou sans respecter son choix – par exemple des épisiotomies pratiquées sur des femmes qui avaient explicitement indiqué qu’elles n’en voulaient pas, ou encore la pratique barbare du « point du mari » qui reste encore répandue. Cette catégorie inclut aussi le non-respect de l’intimité, la violation de la confidentialité, le non-partage d’information médicale, ou le refus d’acte médical. On peut également citer les cas de détention des patientes des structures de santé – que j’ai vus souvent dans certains contextes, lorsque les femmes sont prises en otage avec leur bébé dans la structure, tant qu’elles ne peuvent pas payer les frais liés à l’accouchement...
Combien de femmes sont concernées dans le monde ?
Nous n’avons pas de chiffres précis sur l’ampleur des VGO dans le monde, étant donné qu’un énorme tabou a très longtemps enveloppé ces violences. Elles restent encore très peu documentées, et lorsqu’elles le sont, ce sont surtout les violences obstétricales et moins les violences gynécologiques qui sont documentées.
Mais certaines études nous donnent une idée de l’ampleur des violences.
Par exemple, une étude publiée en 2019 dans le journal The Lancet sur les violences obstétricales dans 4 pays - Ghana, Guinée, Myanmar, et Nigeria – indique que 35% à 42% des femmes avaient subi de telles violences et discriminations. En Belgique, une enquête citoyenne menée en 2021 par la Plateforme pour une naissance respectée indique que 40% des femmes interrogées avaient subi des violences lors de leur accouchement.
Qu’est-ce qui a permis une libération de la parole dans certains pays et qui la bloquent dans d’autres ?
On a commencé à parler de ces violences dans le débat public depuis les années 2000, grâce aux activistes latino-américaines qui sont les premières à s’être mobilisées.
On peut dire que c’est d’abord la maturité des mouvements féministes qui permet une certaine libération de la parole autour de ce sujet. Aujourd’hui, il y a un consensus pour dire que les violences gynécologiques et obstétricales sont avant tout des violences basées sur le genre : les femmes sont victimes de ces violences parce qu’elles sont des femmes, et parce que le corps des femmes est associé à un ‘objet’ dont on peut disposer. C’est pourquoi les organisations féministes sont les premières à porter cette lutte.
Ensuite, il peut y avoir un évènement tragique et choquant qui soit repris par les médias, et qui fasse effet boule-de-neige avec une mobilisation plus large de la société civile autour du sujet. Par exemple au Sénégal, un gros scandale a éclaboussé un hôpital public où une jeune femme et son bébé sont morts du fait de violences obstétricales : la jeune femme a supplié le personnel de l’hôpital de lui faire une césarienne, car elle sentait qu’elle allait mourir sinon; mais les prestataires de santé l’ont laissée agoniser pendant 20 heures sans s’occuper d’elle, sous prétexte que son opération n'était pas prévue. Ils l’ont laissée mourir ainsi que son bébé, dans des souffrances terribles. Ce cas a fait un véritable tollé dans le pays et des mouvements se sont mobilisés contre les VGO à partir de là.
Les pouvoirs publics peuvent aussi décider de s’emparer du sujet au vu de l’enjeu majeur d’accès à la santé que cela représente. C’est ce que l’on a vu en France lorsque Marlène Schiappa, alors Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, a commandé un rapport au Haut Conseil à l’Égalité des femmes et des hommes (HCE) sur les violences gynécologiques et obstétricales. Le rapport a été publié en 2018 et a permis de faire un premier état des lieux du problème en France. C’est un document majeur, parce qu’il a publié de nombreuses paroles de femmes, et parce qu’il a montré que les institutions au plus haut niveau engageaient une démarche sur le sujet.
Il faut avoir en tête que les représentants du corps médical peuvent avoir des réactions au sujet des VGO pouvant aller du déni total à la justification des abus au motif que « ce n’est pas la faute des personnels de santé, mais la faute au manque de moyen, au manque de temps, au manque de ressources humaines » etc. Alors qu’en réalité, reconnaitre l’existence des VGO et de leurs causes ne peut qu’améliorer l’accès à la santé et la fréquentation de structures de santé par les femmes et les filles.
Les institutions ont longtemps ignoré ces violences et sont restées passives précisément parce qu’elles étaient trop souvent justifiées et excusées par le corps médical.
Par conséquent, il est fondamental que des autorités se positionnent sur le sujet pour s’en démarquer, pour visibiliser le problème, le documenter, exiger l’application des protocoles de soins respectueux, et forment tous les prestataires de santé aux soins respectueux; et bien évidemment allouent les ressources nécessaires à la santé et notamment la santé des femmes et des filles.
Est-ce que certaines catégories de personnes sont davantage exposées à ces violences ?
Oui absolument, il y a une vulnérabilité accrue de certaines personnes aux VGO, du fait d’une superposition de caractéristiques qui constituent ce qu’on appelle « l’intersectionnalité ».
Je parlais tout à l’heure des commentaires discriminants et stigmatisants : on observe qu’ils vont être plus ou moins fréquents selon l’âge de la patiente ou son statut marital, son statut socioéconomique – par exemple lorsqu’une femme qui consulte est très pauvre, ou si elle est migrante, si elle est atteinte du VIH ou porteuse d’un handicap, etc. Il y a aussi bien sûr les dimensions de race, d’ethnie, et de religion qui influent sur les discriminations et l’ampleur des violences subies par les patientes.
Par exemple en France, nous avons toutes et tous déjà entendu parler du « syndrome méditerranéen » - cette forme de discrimination selon laquelle les personnes d'origine maghrébine, noire, voire d'autres minorités seraient moins résistantes à la douleur et les exagèreraient. Ce qui est bien sûr un mythe et une forme supplémentaire de stigmatisation, qui a des conséquences dramatiques en termes de prise en charge médicale.
Il arrive aussi que les adolescentes et femmes non mariées - soient plus fortement discriminées. Je me souviens par exemple de cette discussion dans un pays africain où la sage-femme avait refusé d’accorder une contraception à une jeune fille de 13 ans qui était venue la lui demander. Trois mois plus tard, la jeune fille était revenue en pleurs avec sa maman : elle était enceinte, dans un pays où l’avortement reste totalement interdit. La sage-femme s’en voulait terriblement, réalisant qu’elle était responsable de cette situation pour avoir discriminé cette ado uniquement sur un critère d’âge, alors que rien n’interdisait dans la loi de lui accorder une contraception.
Enfin, il faut noter que le type de sexualité ou d’identité de genre peuvent aussi être une cause de vulnérabilité accrue aux VGO - car ces violences peuvent se produire tout au long de la vie non seulement des femmes, mais aussi des LGBTQIA+ - des hommes trans ou des personnes non binaires.
Pourquoi lutter contre ces violences est un enjeu majeur à la fois pour le droit des femmes, mais également un enjeu de santé publique et de développement ?
La première raison de s’attaquer à ces violences de manière urgente est qu’elles ont un impact énorme sur la santé des femmes ! Une commission du Lancet a d’ailleurs écrit que « la mauvaise qualité de soins est désormais le premier obstacle pour réduire la mortalité maternelle (et infantile) » dans le monde « plus que le manque d’accès aux soins ».
- Il y a d’abord les conséquences directes physiques très graves des VGO - qui peuvent aller jusqu’à la mort de la patiente ou son bébé..
Il peut y avoir aussi des séquelles physiques – par exemple après une épisiotomie qui laisse des lésions au périnée et cause des douleurs violentes et permanentes, ce qui peut empêcher de porter un pantalon ou même de s’asseoir ! - Les conséquences psychologiques et les traumatismes liés aux VGO peuvent être aussi très importants. Les filles et les femmes victimes peuvent se retrouver en état de stress post-traumatique, ne plus arriver à se concentrer ou à dormir, avoir des cauchemars ou des flashbacks… Il peut aussi y avoir des impacts au niveau cognitif ou émotionnel, et sur le système nerveux – devenir irritable, avoir des comportements autodestructeurs. D’ailleurs, cet aspect des traumas est bien abordé dans le documentaire « Tu enfanteras dans la douleur »…
- Mais il y a aussi un deuxième niveau de conséquences sur la santé, indirectes, mais tout aussi dramatiques. Souvent, les femmes qui ont subi ces violences vont avoir tendance à purement et simplement éviter toute consultation gynécologique ou choisir de mentir, ou de ne plus poser aucune question lors des rendez-vous médicaux de peur d’être jugées : c’est très problématique parce que c’est une entrave au bon diagnostic.
Est-ce qu’on tend vers une plus grande reconnaissance des VOG dans le droit ?
Oui, il y a eu une reconnaissance progressive des VGO en droit ces 15 dernières années, mais cela se limite encore au continent sud-américain.
Le Venezuela est le premier pays au monde à avoir inscrit en 2007 « les violences obstétricales » dans sa loi, grâce à la pression des associations féministes. D’autres pays d’Amérique latine comme l’Argentine (2009), le Chili (2015), la Colombie (2017), l’Équateur et l’Uruguay (2018) ont suivi cette voie juridique pour sanctionner les violences obstétriques. On a vu aussi les États fédérés d’autres pays sud-américains adopter des lois contre les VGO. Par exemple au Mexique, dans les États du Chiapas et de Veracruz.
Mais globalement, il y a encore très peu de lois dans le monde qui définissent les VGO dans l’arsenal législatif. Et les lois qui peuvent constituer une base contre les VGO peuvent se retrouver confrontées à d’autres lois qui vont dans le sens inverse et sont contraires aux droits des femmes. Les violences sont notamment fortement exacerbées par la pénalisation de l’avortement dans de nombreux pays. Cette situation est bien illustrée dans le film documentaire « Que sea ley » qui montre l’ampleur des violences gynéco-obstétricales commises en Argentine contre les femmes ayant subi un avortement clandestin ou une fausse couche (avant que l’IGV ne soit légalisée). Même chose au Brésil (et là je vous renvoie au film « Levante » !).
En Europe, nous sommes en retard par rapport à l’Amérique latine; il n’y a à ce jour aucun pays européen qui ait adopté une législation pour criminaliser les VGO. Alors que cette problématique est apparue dans le début public depuis plus de 10 ans, et que le Conseil de l’Europe a adopté depuis 2019 une résolution et des recommandations sur les violences obstétricales et gynécologiques. En France, nous avons vu des mobilisations sociales depuis une dizaine d’années relayées dans les médias, notamment autour de dénonciations du « point du mari », et des mobilisations sur des réseaux sociaux et des blogs #PayeTonGyneco ou #PayeTonUterus. Mais malgré le rapport de 2018 du HCE, il n’y a aucune loi spécifique qui a été votée.
Qu’est-ce que les VGO révèlent sur les systèmes de santé à travers le monde ?
Aujourd’hui, comme je le disais, on voit qu’il y a un consensus pour reconnaitre ces violences gynécologiques et obstétricales avant tout comme des violences basées sur le genre : elles s’inscrivent d’abord dans le cadre d’un système patriarcal qui engendre des inégalités systémiques entre les hommes et les femmes.
En second lieu, on considère que la surreprésentation historique des hommes dans les plus hauts postes médicaux des services de gynécologie et d’obstétrique est un facteur qui a favorisé ces violences. Par exemple en France, 90% des membres du Conseil national de l’Ordre des médecins sont des hommes, et les trois quarts des gynécologues et obstétriciens français sont des hommes (74%). Cette « domination masculine » du monde médical se couple à une « domination scientifique » : la personne qui détient le savoir possède un certain pouvoir sur la personne soignée. Or, dans de très nombreux contextes, on ne remet jamais en cause la parole du soignant qui est le « sachant », ce qui favorise les VGO. Le rapport du HCE français sur les VGO a souligné le fond de sexisme sur lequel ces violences sont commises.
Une autre cause de ces violences est la « sur-médicalisation » de l’accouchement et l’appropriation du corps des femmes par le corps médical.
Ce qui est très paradoxal , c’est que ces violences sont apparues alors même que l'on cherchait à améliorer la santé des femmes et leur accès au monde médical. Ces 20 dernières années, l’accouchement s’est très fortement médicalisé, ce qui a permis une forte réduction de la mortalité maternelle et infantile. Mais le problème, c’est que cette « hyper-technicisation » a entrainé une déshumanisation – on ne voit plus que des ‘organes’ et non des personnes. C’est allé de pair avec une « pathologisation » de toutes les étapes de la conception à l’accouchement . Cette dynamique a ôté le pouvoir d’action et de décision des femmes : leur capacité de décision a été appropriée par le corps médical, ce qui est venu avec un lot de pratiques violentes et irrespectueuses.
Enfin, ces violences sont également révélatrices de la pressurisation des systèmes de santé dans la majeure partie des pays du monde. Ces systèmes souffrent d’un manque de ressources – des pénuries de personnel à la vétusté des infrastructures, en passant par le manque d’équipement et de fonds pour leur fonctionnement. Tout cela conduit à des conditions de travail très dégradées. Sans compter les logiques de rentabilité appliquées aux structures de santé.
Le manque de formations adéquates est un réel enjeu, et là aussi ce qu’on observe souvent est que les inégalités de genre se manifestent au sein même de ces formations : les sages-femmes - qui sont généralement des femmes – y ont moins facilement accès comparé aux médecins - qui sont le plus souvent des hommes dans les pays d’intervention de l'AFD.
Toutes ces pressions et ces sous-investissements dans le secteur de la santé constituent un terrain qui favorise l’apparition des violences gynécologiques et obstétricales, même s’ils ne l’expliquent pas.
Par Rédaction Tilt
Merci à Nelly Reliat pour le partage de son expertise 🙏
✊
J'agis

Société
Les violences gynécologiques et obstétricales, ça veut dire quoi ?


Société
ITW avec Perrine Bonvalet-Döring : le droit à l'avortement dans le monde

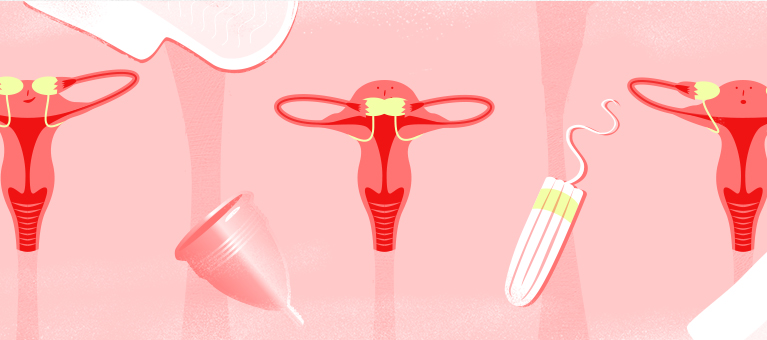
Société
La précarité menstruelle, ce fléau qui touche beaucoup de femmes
